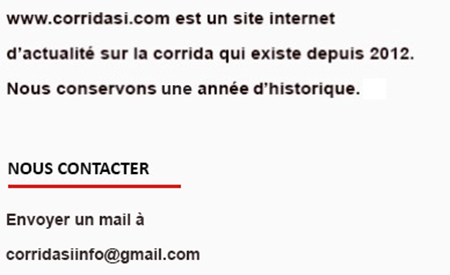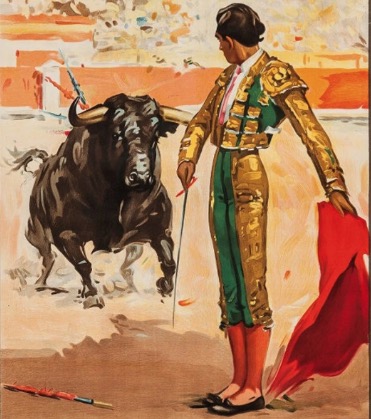
Par François Zumbiehl, professeur de littérature classique et docteur en anthropologie. Il a été conseiller culturel à l’Ambassade de France en Espagne et directeur adjoint de la Casa de Velázquez à Madrid. Il vit entre le Pays basque et Madrid
Extrait article dans Sud-Ouest
Depuis la fameuse réplique lancée par Cúchares à un acteur qui, assis sur les gradins, lui reprochait vertement son manque de courage – « Ici, Monsieur, on meurt pour de vrai » – la différence entre la fiction du théâtre et la réalité des arènes est devenue un lieu commun. Cette différence ne doit pas faire oublier que le toreo et tout ce qui se produit sur le sable de la piste composent aussi, avec un autre langage que les mots, un art scénique, fait pour toucher le public auquel ils s’adressent. Santiago Martín El Viti, peu suspect de jouer les histrions, disait que le bon torero ne doit pas seulement se préoccuper de toréer et de dominer le taureau, mais aussi de « vendre » ce qu’il est en train de faire, c’est-à-dire de faire en sorte par sa façon de se comporter dans l’arène que les spectateurs captent le sens et l’émotion de chacun de ses gestes.
Quelle différence avec le théâtre ?
Tout ce qui survient dans une corrida est réalité, mais aussi représentation. Il est clair ici qu’une représentation n’implique pas une absence de vérité, mais une vérité qui se situe au-delà des apparences physiques, et qui peut se lire grâce à elles. C’est ce que permettent les signes. Ils sont ici innombrables. Certains sont fixés par le protocole : les saluts avant et après le paseo, les brindis, les alternatives, les tours d’honneur (du torero ou de la dépouille du taureau), les sorties en triomphe sous condition selon les arènes… D’autres appartiennent à une liturgie implicite et reconnue : le signe de croix tracé par le pied à l’entrée sur le sable, le baiser de la timbale d’argent avant de se voir remettre la muleta, le bras levé ou tendu vers le taureau pour annoncer et saluer sa mort, la poignée de sable baisée et comme enfouie dans son gousset par le matador triomphant, geste de gratitude et d’adieu pour ceux qui l’ont applaudi… D’autres sont faits pour souligner et indiquer aux spectateurs la tonalité particulière des phases marquantes des prestations : les desplantes (attitudes de défi) pour ponctuer la fin d’une série réussie, avec le plus souvent la brusquerie d’une colère simulée dans ce moment heureux, ; un pan de la veste ouverte avec la main comme une façon de s’offrir à la charge de la bête ; le rictus, de tension et de plaisir, déformant la bouche du torero depuis le prélude jusqu’au terme de la passe (est-il instinctif, convenu ?)…
Avec tous ces gestes nous comprenons qu’en marge du rituel et des figures imposées du répertoire technique et artistique, chaque après-midi de taureau – où surgissent une œuvre et une rencontre entre l’homme et la bête qui ne se retrouveront plus – nous raconte son histoire particulière. Elle vaut la peine qu’on y soit attentif.