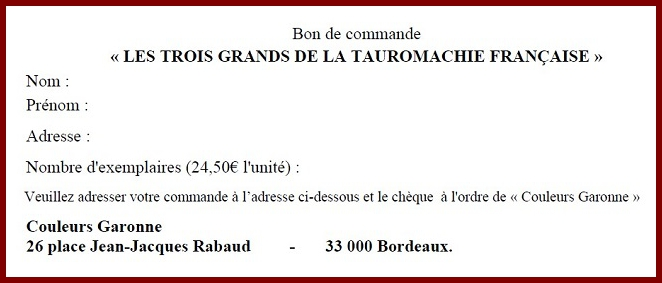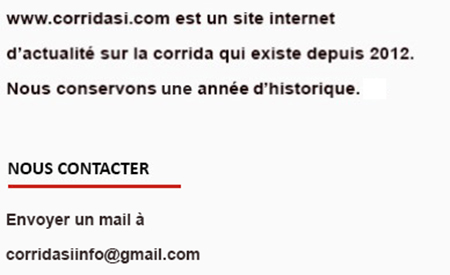En ce début d’année nous vous proposons de poursuivre la lecture de ces livres taurins qui ont paru récemment et qui nous passionnent. C’est le cas de cet ouvrage d’Antonio Arévalo: “Les trois grands de la tauromachie française” : Nimeño II, Juan Bautista et Sébastien Castella. Le premier, Nimeño, fut une sorte de précurseur qui ouvrit la route, le second obtint la consécration suprême, le troisième fit valoir une manière inspirée de ce qu’il y a de meilleur dans ce que l’on nomme le « génie français ». Après Nimeño, poursuivons la lecture de ce livre d’Antonio lors de sa rencontre avec Juan Bautista qui évoque ici les débuts de sa vocation

Avant tout, j’ai une chose à dire : depuis mon enfance je n’ai eu d’autre rêve que de devenir torero. Tout petit, j’étais déjà passionné. Quand j’allais aux corridas avec monpère ou ma mère, qui était très aficionada, à Nîmes ou à Arles, je me souviens de cette sensation d’énorme tristesse que je ressentais au dernier jour de la feria, car il me faudrait attendre des mois pour revenir dans ces arènes. J’étais vraiment ému, c’est là que j’ai voulu être torero.
Pour mon apprentissage, j’ai été très autodidacte. J’ai regardé, écouté, vu plein de vidéos. Pour connaître les bases de la tauromachie, faire mes premiers pas, j’ai surtout observé. Après, bien entendu, j’ai eu des conseillers. Le premier d’entre eux fut un aficionado « practico », ami de mon père : Jacques Coule. Il était voisin de notre propriété familiale et participait à beaucoup de tientas. Les premiers conseils furent les siens. Quand j’ai eu douze ou treize ans, le matador Patrick Varin venait chez nous, souvent expressément pour s’entraîner de salon avec moi. Il y eut aussi Richard Milian, quand il était en tienta, Gilles Raoux, qui débutait sa carrière de novillero et Curro Caro, dont les conseils me permirent de beaucoup progresser. Le voir toréer de salon était un spectacle, Patrick lui aussi toréait à la perfection. J’avais déjà un toreo en tête, mais je m’imbibais de toutes ces expériences. J’ai eu plus tard la chance de voyager. Je devais avoir treize ou quatorze ans, mon père était l’apoderado d’Antonio Ferrera, j’ai passé des semaines dans la maison familiale d’Antonio à Badajoz. Nous partions souvent chez l’éleveur Simon Malta. Ce fut une étape très importante dans mon apprentissage car j’ai pu vivre de près la préparation d’un torero, aussi bien physique que mentale, entrevoir la dureté qu’implique ce métier.

—Tu as toujours été un perfectionniste, quand ressens-tu que l’exécution, le tracé de
certaines passes est celui que tu recherchais ?
–Ces débuts remontent assez loin, il me faudra rafraîchir la mémoire. Je me souviens plutôt de moments que de faenas, où j’étais parfois surpris moi-même d’arriver à faire ce que j’avais en tête. Je débute en piquée à Querétaro, au Mexique, aux Rencontres Mondiales des Novilleros. J’en sors triomphateur, reviens quinze jours plus tard et à partir de là je me fais un petit circuit en Amérique, au Mexique et en Équateur. L’été, je rentre en Europe mais c’est l’hiver qui va être déterminant pour moi. Au début de ma seconde saison en piquée, je me présente à Nîmes en février 1999. Quand je gracie le novillo d’Ortega Cano et Rocío Jurado, je suis conscient d’avoir franchi un cap dans mon évolution comme torero, ça m’a apporté énormément de confiance. J’ai ensuite enchaîné des succès qui m’ont permis de me faire connaître. À Nîmes, Castellón, Valence, Barcelone et bien entendu Madrid. J’avais vu des corridas de Madrid à la télé mais, avant mon premier paseo, je n’y avais été qu’une seule fois comme spectateur, pour les adieux d’El Juli comme novillero, où il avait affronté six novillos, un après-midi avec beaucoup de vent. On m’avait dit que c’était rude, très compliqué de toréer à Madrid, mais ce jour-là je ne l’ai pas ressenti, plutôt le contraire. J’étais calme, serein, j’ai tiré le maximum de deux novillos moyens et leur ai coupé une oreille à chacun. Sincèrement, j’ai même trouvé ça facile de triompher à Madrid.