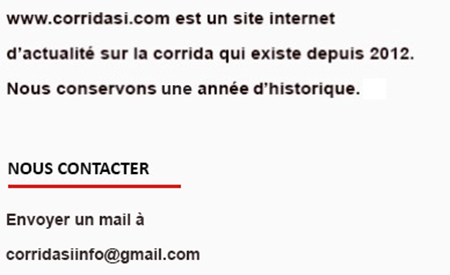Le dicton taurin le dit : « tarde de expectacion, tarde de decepcion »* ; très attendue ma soirée consacrée au film d’Albert Serra qui a suscité controverses critiques ou louangeuses, m’a plongé dans une certaine indifférence, un ennui marqué par des situations répétitives avec une forte impression de « déjà vu », une banalité contraire au sujet, la tauromachie, qui est tout sauf une activité sans surprise.
Ce n’est pas le grand film lyrique que l’on attend (toujours) sur la corrida, ce n’est pas non plus une critique abjecte ou polémique, ce n’est qu’une description plate d’une réalité vue d’en bas plutôt que d’en haut, un point de vue qui certes fait de l’effet (visuel) mais n’éclaire rien. On n’y voit que ce que l’on sait déjà et les émotions, les coups de cornes notamment, ne touchent que peu puisqu’on en connaît l’issue.
A quoi servent ses scènes répétées d’arrastre ? Ces puntillazos successifs ? Ces passes accumulées dégagées du contexte d’une faena et par conséquent sans significations véritables ? La vie d’un torero se limite-t-elle à la camionnette qui le conduit et à la chambre d’hôtel où il ne dort pas ? On aurait aimé justement voir celle où il dort… (et avec qui).
On n’est ici loin de Cocteau, Hemingway ou Peyré ou pour prendre des exemples de films qui nous ont transporté, loin « Des clameurs se sont tues » de Dalton Trumbo, de « La course de taureaux » de Braumberger, de « Moments de vérité » de Rosi ou « Des golfos » de Saura, etc.
Le film a néanmoins un mérite: il n’est pas de partie pris ; il est honnête ce qui n’est pas rien tout de même. D’abord il a mis au centre du propos le toro bravo et les deux premiers plans au campo dans la nuit avant même le générique sont réussis. Il n’élude pas la violence de l’animal dans le combat, ses intentions criminelles ne sont pas masquées, ni sa mort souvent choquante pour les « enfants du siècle » qui ne reconnaîtront jamais son aspect glorieux : cette lutte ultime pour la vie, ce dernier regard la lumière.
Ensuite le réalisateur n’a pas éludé le côté picaresque du milieu taurin. Les répliques de Chacon ou Viruta, les peones de Roca sont tordantes pour celui qui sait les contextualiser. Il y a cet amour du piropo très sévillan, le goût du bon mot et une façon de convoquer la vulgarité qui n’est pas triviale mais rappelle les racines populaires de ces O.S. de la tauromachie. A lire les critiques de la presse française, je ne suis pas sûr que le « grand public » saisisse cet amour du second degré, la frivolité feinte et l’ironie savoureuse de ces grands professionnels issus de barrios populaires où on parle ainsi…
Enfin le film met à a sa place Andrés Roca Rey, c’est-à-dire à celle de numéro un, de torero d’époque. La seule comparaison possible étant José Tomas évoqué incidemment (?). Le comportement héroïque du Péruvien s’impose de manière indubitable tout au long des scènes: son arrimon, son entrega, el valor seco qui en fait un torero hors norme qui marque l’histoire. Un phénomène ! La contrepartie, celle qui lui est demandée, est terrible : outre les blessures physiques et cette angoisse de ne pas les voir « se cicatriser », il y a le poids de la responsabilité, cette lourde solitude pour un jeune homme de 25 ans. Etre numéro uno, assumer ce rôle, remplir les arènes et être celui à qui on demande toujours plus c’est subir une pression quasi inhumaine. Les plus grands y sont passés on citera Juli et surtout Ojeda ou Tomas, ces derniers n’ayant que peu duré à ces avant-postes
Cette souffrance du Numéro Uno on la lit sur le visage lisse -enfantin encore- mais souvent ensanglanté d’Andrés. Et on sent que la seule chose qui le préoccupe, celle qui le touche, ce sont les cris de haine, ces insultes du tendido 7 madrilène ou le scepticisme de la Maestranza. Je ne sais si c’était là le propos initial de Serrat mais il touche enfin une vérité profonde : l’injustice blesse toujours plus que le coup de corne.
Pierre Vidal
* « Après-midi d’espérance, après-midi de déception »