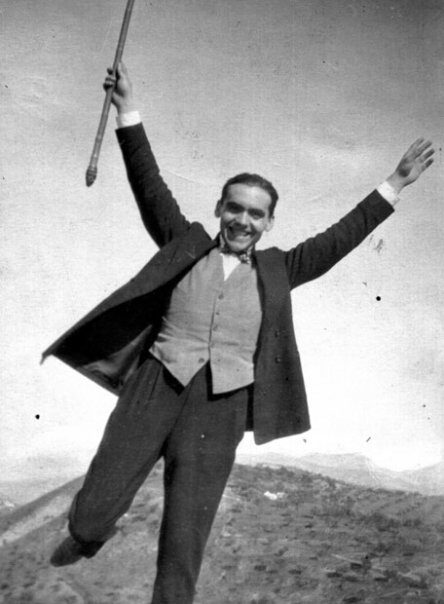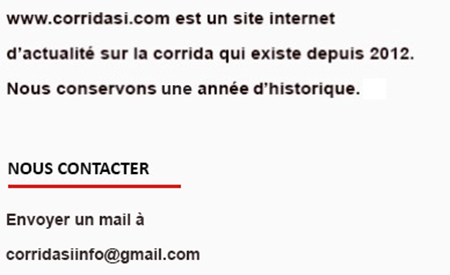Ce n’est pas une faute ni un hasard si j’ai écrit art avec une majuscule.
En effet, le comportement de Mr Urtasun ministre espagnol de la culture relève en matière de bêtise, de grossièreté et d’ignorance crasse des règles de la bienséance minimum à l’égard du roi, de la reine , de la tauromachie représentée en l’occurrence par Julian Lopez El Juli.
Explication: sur une même ligne , debout et applaudissant El Juli , de gauche(en effet!) à droite
le sieur Urtasun ci devant ministre étiqueté Catalogne en commun extrême gauche; puis le Roi d’Espagne, puis la Reine.
Le matador honoré arrive pour saluer cet aréopage et, en homme bien élevé se dirige droit vers le Roi et la Reine qu’il salue en premier. Notons au passage que l’annonce de l’arrivée du Juli était unanimement applaudie avec chaleur et sourire bienveillant par le roi et la reine, mais pas par le malheureux idiot que l’Espagne a pour ministre de la culture, lequel garde comme un cache sexe ses deux mains croisées à hauteur de sa braguette.
Ayant ainsi échangé avec le souverain une poignée de main franche et cordiale et quelques mots pleins de respect et d’admiration, le torero s’est alors dirigé main tendue vers le ministricule.
Tordant le nez, d’un air dégouté le sus nommé ministre n’a pu refuser la main du torero qu’à ce moment là, je l’avoue j’aurais bien voulu voir armée d’une lame pour un ‘julipié » rapide et efficace!
Et pendant ce temps là, chez nous, le même style d’imbéciles bien sûr trotsko gauchistes refusent aussi de serrer la main de leurs collègues qui ne partagent pas leurs « opinions », même bétise crasse, même intolérance qui autorise des fascistes de gauche à traiter de nazi quicinque ne pense ni n’agit comme eux.Les Caron, Panot préparent dans leur coin des projets de loi liberticide contre la corrida avec la complicité étrange de gens qui, allez savoir pourquoi, du centre ou de la droite dite « republicaine », se cachant derrière leur petit doigt en disant: notre projet n’interdit pas la corrida, il veut juste l’interidre aux moins de 16ans….Ah Mr le sénateur Pariât, passé par toutes les couleurs politiques, patron du domaine de Chambord et de ses chasses , chasse faut il le rappeler dont en France on obtient le permis dès l’âge de 15ans, cherchez l’erreur..
A un moment où les arènes se remplissent à nouveau de jeunes passionnés qui sont la relève du public vieillissant que l’on voyait sur les gradins, à ce moment précis où l’ancien projet de loi repoussé du triste Caron l avait été avec clarté, le jeune public comme le plus âgé s’apercevant que les toreros étaient des jeunes gens pleins de qualités , de courage et d’humanité, voilà que les animalistes antispécistes reviennent en scène et veulent interdire la corrida aux jeunes gens.
Urtasun, Podemos, Ecolo punitifs, LFI même combat, et même les Macronistes comme Patriat ex PSU ex PS et ces gens viennent vous parler de démocratie.
J’ai vu ma première corrida à 14ans et n’en ai retiré que le sens du beau, l’admiration pour le courage des toreros et la splendeur de l’animal le plus respecté au cours des siècles depuis la haute antiquité: le taureau.
Jean François Nevière